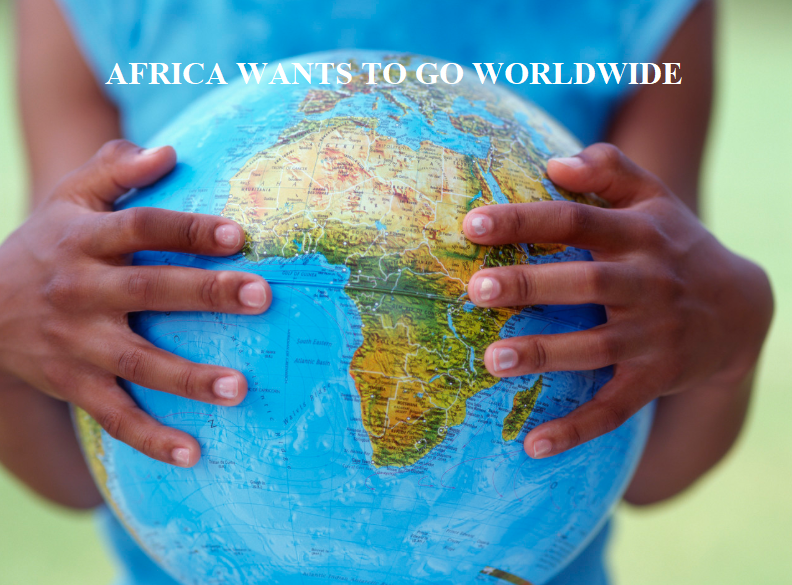Les règles (asymétriques) appliquées au commerce avec les pays du continent africain ont, pour l’essentiel, été posées et entretenues par l’un ou l’autre des pays de l’UE, ex-colonisateurs de l’Afrique. Sur le plan économique et commercial elles visent, hier comme aujourd’hui, à maintenir nos pays fermement attachés aux européens et leur mainmise sur nos richesses. A ce propos, le « marché européen » peut être compris comme le « marché français » dans de nombreux pays en Afrique francophone. Nous nous référons dans cet article au cas du Maroc, mais la situation peut être comparable dans d’autres pays du continent. Ainsi, à titre d’exemple, il y a environ une trentaine d’années, l’essentiel du parc automobile national était constitué chez nous de véhicules de marques françaises. Les exportateurs de véhicules asiatiques comparables ont dû fournir un effort colossal pour accéder au marché marocain. Au départ, ils ont dû se résigner, entre autres, à payer 10% de taxes de plus que leurs concurrents de l’UE. Aujourd’hui encore, les européens continuent de bénéficier de grands avantages hérités, et préservés, de l’époque coloniale comme de meilleurs emplacement pour leurs show-rooms, ou bien des circuits bien huilés d’importations et distribution de pièces détachées et une administration majoritairement acquise à leur cause, etc.
En plus des véhicules, des investisseurs non-européens ont réussi à s’implanter chez-nous sur des marchés de niche tels que l’aéronautique ou l’éolien. Mais l’investissement dans l’agroalimentaire, secteur clé de l’économie nationale, où le Maroc bénéficie d’un potentiel d’avantages comparatifs très favorables, en ressources naturelles et autres, est toujours dominé par des opérateurs franco-européens (français ou autre européen). En plus de la connaissance de nos « us et coutumes », l’autorité « coloniale résiduelle » (la ribambelle d’organismes qui travaillent pour l’UE), qui a des yeux partout, a pesé de tout son poids pour verrouiller le secteur agroalimentaire par de nombreux règlements et lois qui sont, pour une bonne partie, encore en vigueur à ce jour. Le « mérite » en revient à certains bras cassés, parmi nos responsables des Ministères de tutelle, qui se complaisent dans les basses besognes du « copier/coller » et du maintien en application, contre tout bon sens, de textes réglementaires mis en place parfois du temps du protectorat pour servir les intérêts du colonisateur. L’essence des lois en question est de pérenniser les types d’échanges qui favorisent largement les franco-européens au détriment d’autres investisseurs intéressés. Autrement dit, les textes réglementaires dans leur globalité visent à maintenir l’importation de produits finis « Made in UE » (Made in France), payés chèrement en Euro, et l’exportation de Matières Premières bradées vers l’Europe. L’exemple de l’accord de libre-échange signé entre le Maroc et les USA depuis bientôt quinze années, et resté à ce jour lettre morte, illustre bien à quel point les franco-européens sont omnipotents sur notre marché national. La multitude des outils (textes réglementaires et pratiques) employés dans ce sens sont abordés dans d’autres articles de ce blog. Dans ces conditions, un investisseur non européen désireux de s’engager dans un segment ou un autre de notre secteur agroalimentaire, et qui tient à pérenniser sa présence, n’a eu, à ce jour, d’autre choix que de se faire adoubé par le lobby franco-européen ou bien, ce qui revient au même, prendre comme partenaire un franco-européen. Sous ce rapport, le passage en revue des opérateurs qui comptent dans le secteur agroalimentaire marocain, tous segments confondus, montre que cette règle a effectivement été largement suivie.
Aussi, parmi les entreprises évoquées plus haut, qui sont bien installées sur le marché national, certaines font valoir des documents de certification et/ou de contrôle qualité qui sont édités et signés à l’étranger (nos archives). Dans la mesure où, à notre connaissance, le Royaume du Maroc n’a pas signé avec les pays de l’UE d’accord de reconnaissance mutuelle de ce type de service, la validation illicite de tels documents pour l’usage sur notre marché national participe du mépris caractérisé que nos voisins du nord, aidés en cela par leurs commis locaux, ont pour nos institutions ainsi que pour notre souveraineté nationale. Selon notre opinion, cette supercherie, vérifiable à tout moment, est d’abord à mettre au compte de certains fonctionnaires (qui ont fait leur temps) de l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments), l’organisme de tutelle sur notre secteur agroalimentaire, qui enfreint, de facto, la réglementation en vigueur au Maroc alors qu’il est supposé veiller sur sa saine application. Les données disponibles montrent que de tels documents d’essence coloniale circulent largement ailleurs en Afrique véhiculant de cette façon le même type de mépris à l’égard des réglementations locales. Alors, si, malgré sa grande richesse, l’Afrique compte le plus grand nombre de déshérités dans le monde, la responsabilité incombe aujourd’hui, selon nous, à ceux de nos responsables fainéants susmentionnés, au Maroc en particulier, plus encore qu’aux agissements passés de responsables coloniaux.
Sous ce rapport, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a insisté à de nombreuses reprises sur la solidarité du Maroc avec d’autres pays africains amis et le devoir que notre pays a de contribuer au Co-développement de notre continent africain. S’agissant du secteur agroalimentaire, notre opinion est qu’avant d’aborder un tel programme d’assistance aux autres, le Maroc devrait se délester du type de responsables évoqués plus haut pour regagner en crédibilité auprès des pays désireux d’embrasser le marché globalisé sans règles restrictives d’essence coloniale.
Ceci mis à part, l’UE doit se rendre à l’évidence que le temps de l’exclusivité qu’ils ont eu sur le Commerce/Economie africaine est à présent derrière eux. L’internationalisation du commerce africain qui a démarré est irréversible. En plus d’autres pays comme la Chine, le Japon, l’Inde, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe et autres, il y a dorénavant l’USA qui s’intéresse à commercer directement avec notre Continent. A ce propos, le passage en revue des écrits et autres annonces de responsables UE dans les médias dernièrement laissent paraître une UE qui a perdu de sa superbe. Les européens se posent à présent en victime de ceux qu’ils qualifient de « requins » qui leur en veulent comme la Chine, la Russie et, une première, les Etats Unis. Au lieu de reconnaitre leurs erreurs sur les souffrances et pillages qu’ils ont infligés à l’Afrique, et indemniser en conséquence, ils persistent dans un discours soporifique en promettant à l’ensemble du continent un accord de libre-échange avec à la clé la création rapide de dix millions d’emploi. Il faut être tombé sur la tête pour croire à de telles balivernes assimilant la création d’un emploi à la préparation d’un pot de yoghourt ! De mémoire d’historien, ils ont appauvri ce continent et pillé ses ressources et, à présent, ils promettent de faire en cinq ans ce qu’ils ont refusé de faire en quatre siècles.
En fait, pourquoi les autres puissances en voudraient-ils aux européens ? Il serait bon qu’ils nous le disent. Faut-il rappeler qu’à part l’Allemagne, encore en sursit, les autres pays du continent européen ont de la peine à exporter quoi que ce soit de façon compétitive. Peut-être que les puissances en question trouvent que les européens n’ont plus les moyens de leur politique et qu’il est grand temps pour l’UE de laisser le commerce africain mieux respirer !