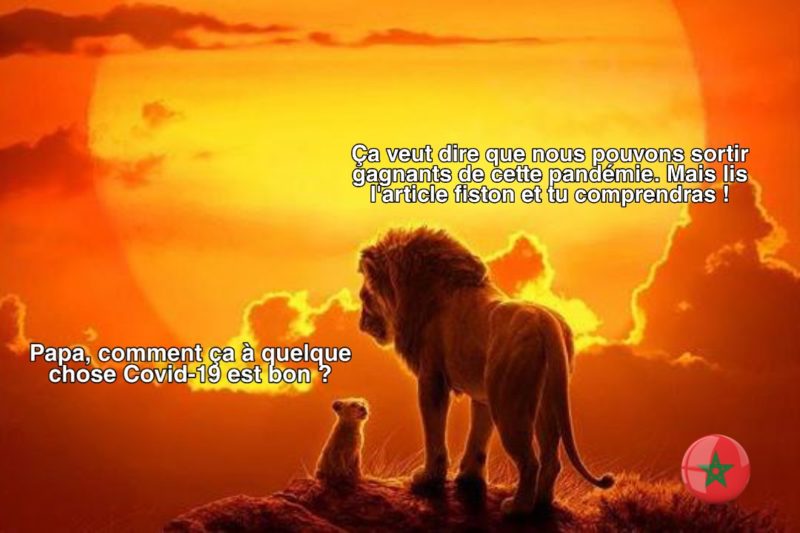Ces derniers temps, des ouvrages1, 2 ont eu le mérite, en particulier, d’analyser sous un nouvel angle de vue les conditions dans lesquelles des pays africains ont accédé à leurs indépendances. Les auteurs se sont intéressés aux événements de la libération coloniale après la deuxième guerre mondiale et montrent, entre autres, que pour les empires coloniaux, après avoir formé des élites autochtones selon leur concept, ils pensaient le temps venu de remettre les rênes du pouvoir à des responsables locaux pour poursuivre sur le chemin qui leur a été tracé. Mais pour les militants africains, au contraire, l’indépendance a été obtenue de haute lutte. Le fait est que, s’agissant de l’aspect des échanges sur le plan économique et commercial, les ex-empires coloniaux n’ont jamais cessé de jouir jusqu’à aujourd’hui de privilèges considérables dans les échanges très biaisés qui lient nos pays africains à nos ex-colonisateurs européens. Et cette même situation a freiné jusqu’ici la possibilité pour nos pays de développer des échanges économiques et commerciaux ailleurs sur la planète. Vu sous cet angle, l’indépendance de pays africains des années cinquante et soixante du siècle passé semble avoir été tronquée.
Sur le même sujet, s’il est admis qu’après la deuxième guerre mondiale le monde a subi des modifications profondes — Les relations et les échanges internationaux devaient pour la première fois être basées sur le respect des règles de nouveaux organismes comme le FMI, l’OMC, le Codex Alimentarius et autres —, ce changement n’a pas modifié l’essence des liens commerciaux et économiques entre les empires-coloniaux européens et leurs ex-colonies africaines. Les règles en question, qui permettent des échanges très asymétriques entre nos pays africains et les pays européens, ont été régulièrement adaptées par l’UE mais uniquement dans l’esprit de perpétuer les privilèges issus de l’ère coloniale. La parole de nos dirigeants, si parole il y avait, était alors inaudible ou bien largement ignorée. Il faut tout de même dire que, équité mise à part, les colonisateurs européens n’avaient aucune raison de modifier des « rapports de coopération », avec des pays soumis, qui servaient extrêmement bien les propres intérêts de l’Europe coloniale. Au contraire, ils ont tenu par tous moyens à conserver ces privilèges économiques et de commerce acquis à l’origine par la force dans les relations qu’ils continuent de nous imposer depuis l’ère coloniale. Ensuite, l’UE a systématiquement saboté par un moyen ou un autre tout effort visant à remettre en cause les fondements asymétriques des échanges qu’ils maintiennent avec nos pays.
Pour le secteur agroalimentaire, cela a consisté, entre autres, à pérenniser un accès continu et sans réserve de l’UE à nos ressources naturelles. Dans ce but, une stratégie politique ad hoc a été mise en place dont la PAC (Politique Agricole Commune) et les milliers de normes logorrhéiques UE sont parmi les éléments saillants du dispositif. Ce quadrillage UE de nos richesses a été conçu pour résister supposément à toute épreuve.
Mais, apparemment, l’apparition de la présente pandémie (Covid-19), qui est en route pour perturber tout ce stratagème, ne faisait pas partie de l’analyse prudentielle des gouvernants européens.
Tout d’abord, depuis l’apparition du Covid-19 il y a quelques mois, le monde entier a pu observer que les règles habituelles de fonctionnement du marché commun européen (libre circulation des marchandises et des individus), tant vantées par le gotha de l’UE, sont différemment appliquées d’un pays à l’autre, ou bien simplement ignorées. Et la gabegie est telle que même les citoyens des pays membres du Bloc UE ont de la peine à comprendre ce désordre. Plus que cela, des pays africains à présent paraissent, et c’est une première, s’en sortir beaucoup mieux que les pays de l’UE pour ce qui est de la gestion de cette crise pandémique aussi bien sur le plan sanitaire (disponibilité des masques et autres équipements sanitaires) ou bien sur le plan de la logistique et l’approvisionnement des marchés (disponibilité des produits alimentaires en suffisance à des prix stables) ou bien même sur le plan purement sécuritaire pour faire respecter l’Etat d’urgence sanitaire ou bien le couvre-feu par le public. Sur ce chapitre, le Maroc est couramment cité en exemple à suivre par nombre de responsables français et des médias européens. La Chine, et non l’UE, a aidé dans cette nouvelle perception des choses.
D’un autre côté, selon l’avis de l’OMS et autres organismes de référence, le virus du Covid-19 devrait être là pour longtemps encore. Ces organisations nous rappellent que nous devons apprendre à « cohabiter » avec ce coronavirus non seulement parce que la présence du pathogène va s’inscrire dans la durée, mais aussi comme préparation de nos comportements pour affronter d’autres pandémies qui feront inéluctablement partie de nos modes de vie à l’avenir.
Pour dépasser ce type de fléaux, le monde a besoin d’expériences réussies pour les prendre comme modèles à suivre. Sous ce rapport, l’expérience européenne de gestion du Covid-19, jugée défaillante, ne vient à l’esprit de personne pour constituer un modèle de réussite. En effet, le nombre de décès, rapporté à la taille de la population, y est le plus élevé dans le monde ainsi que le nombre d’infections et le nombre de lits d’hôpitaux congestionnés par le taux élevé de patients en situation de stress respiratoire. A l’inverse, la gestion de la pandémie par les autorités marocaines a, comparativement, été bien plus efficace. En somme, l’Afrique n’a plus besoin de chercher ailleurs les principes d’efficacité, elle les a en son sein.
Ceci étant, et considérant les contraintes d’ordre économique, les européens devraient procéder dans l’avenir proche à la levée de l’état d’urgence sanitaire et du confinement. Après quoi, bon nombre d’entre eux voudront vraisemblablement revenir pour leurs séjours de loisir chez-nous qu’ils affectionnent tant. Si c’est le cas, cela posera probablement un risque sanitaire sur nous autres marocains. Sachant que la réalisation d’un vaccin contre un virus, compte tenu de la taille de la molécule, est un processus complexe qui prend beaucoup de temps, et contre le SARS-Cov-2 (responsable du Covid-19) cela demandera dans la meilleure hypothèse des mois sinon des années, nos responsables au Maroc devraient sérieusement réfléchir à subordonner la venue chez nous de touristes de l’Espace Schengen à la production d’un passeport immunitaire confirmé pour nous prémunir d’éventuelles infections supplémentaires.
A présent si, selon cette recette, nous serions en position de mieux garantir la sécurité sanitaire des marocains, la limitation de la venue d’européens chez-nous impactera négativement le cours de nos exportations vers ces pays. Nous devrions donc dès à présent penser à des alternatives pour maintenir nos activités d’export de produits alimentaires.
Sur ce plan, comme cette pandémie du Covid-19 l’a bien montré, la nourriture est en manque plus ou moins prononcé un peu partout dans le monde et cette insuffisance de l’offre ne demande qu’à être satisfaite. Il est vrai que l’Europe toute proche, juste de l’autre côté du détroit de Gibraltar, est avide de nos légumes et fruits frais qu’elle nous achète à des prix ridicules. Il faut aussi se rendre compte qu’il nous sera plus difficile d’écouler de façon profitable ce même type de marchandises sur des marchés plus éloignés en Asie et ailleurs. Mais si ces légumes et fruits étaient valorisés pour en faire des produits stables commercialement, nous pourrions les exporter partout dans le monde avec des plus-values beaucoup plus intéressantes. Alors, au moment où l’Etat marocain s’apprête à mettre la main dans la poche pour aider les entreprises nationales à redémarrer leurs activités productrices, nos autorités compétentes seraient bien avisées d’insérer parmi les critères d’éligibilité à l’aide de l’Etat l’exigence de valorisation des produits frais localement chez-nous.
Mais n’oublions pas que l’absence de visiteurs étrangers affectera également notre secteur du tourisme, l’Hôtellerie/Restauration en particulier. Il serait peut-être temps aussi de repenser la logique de travail dans ce secteur pour y faire venir des touristes d’autres régions du monde, Amérique et Asie entre autres, qui sont moins familiers avec notre pays. Une des faiblesses, selon notre opinion, du peu d’attraction de notre secteur touristique auprès des touristes en dehors de l’Europe tient au manque de respect des règles appliquées à ce marché très globalisé. En effet, les tours operators (TOs) de l’Amérique du nord et ailleurs ont une aversion du risque inconsidéré contre lequel ils ne peuvent pas souscrire d’assurance pour se couvrir en cas d’impondérables. Au sommet de la liste des éléments de risque à maîtriser par une assurance, il y a le danger d’origine sanitaire. Mais les assurances ne peuvent accepter d’assurer un TO en l’absence de certification HACCP de l’Hôtel/Restaurant qui recevra les touristes. Nos responsables concernés doivent savoir que le développement du tourisme anglo-saxon et asiatique est réellement tributaire d’une mise en place généralisée de certifications contre le risque sanitaire dont la plus en vue est la certification HACCP.
Considérant la pandémie en cours, en plus de la certification HACCP qu’il faudrait rendre obligatoire pour permettre aux TOs du monde entier de nous amener leurs clients, il y a lieu d’y ajouter dorénavant un complément de certification contre le risque du Covid-19.
1) Robert Gildea. Empires of the Mind: The Colonial Past and the Politics of the Present. Cambridge University Press, 2019
2) Britain, France and the Decolonization of Africa: Future Imperfect? Edited by Andrew W.M. Smith and Chris Jeppesen