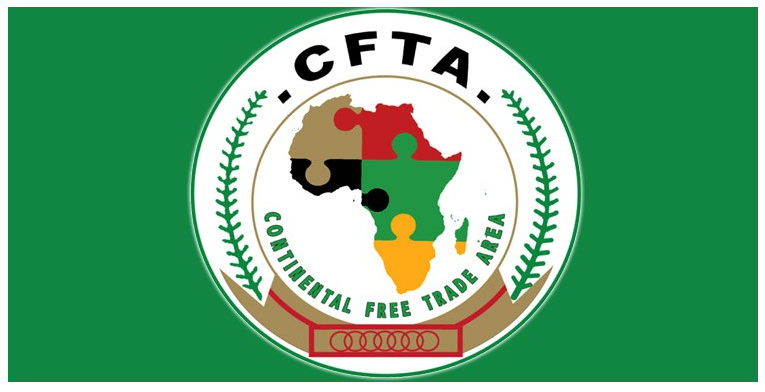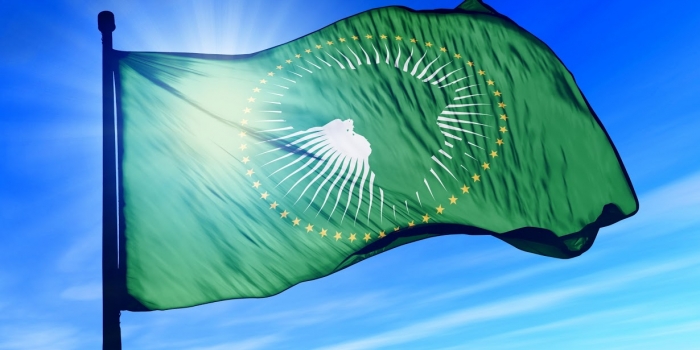L’entrée en vigueur de la Zleca (Zone de libre-échange continentale africaine) est annoncée pour le 30 Mai prochain. Nul besoin de souligner que les responsables de nos pays, chargés de négocier les règles qui soutiendront la concrétisation de cette ambition, ont beaucoup de travail devant eux. Ils peuvent bien évidemment, pour des raisons financières ou de convenance, faire appel à des organismes de l’UE pour les aider dans cette besogne. Il est peu probable qu’une telle démarche soit de nature à accélérer la mise en place de la Zleca, entreprise conçue pour contribuer à déficeler les liens économiques et commerciaux que l’ancien colonisateur a tissés, pour son intérêt, autour de notre continent. Surtout que l’Afrique a grand besoin d’aller vite dans le démarrage de ce projet pour profiter des opportunités immédiates et répondre au besoin lancinant de trouver du travail et la nourriture à sa jeunesse désœuvrée. Ceci aidera par la même occasion à stopper l’hémorragie de l’émigration des pauvres d’un côté et de l’élite africaine également.
Dans le commerce comme ailleurs, les opportunités sont rarement servies sur un plateau. Il faut donc surveiller la tendance des marchés et déduire les possibilités qu’il y a pour en tirer profit. Sous ce rapport, les Etats Unis considèrent, pour des raisons qui les regardent, qu’il leur revient dorénavant de prendre une part plus importante du commerce mondial. Cela a déjà été le cas après la deuxième guerre mondiale. Dans ce but, l’Administration Trump presse les Chinois de leur acheter davantage de produits à des conditions plus favorables pour rééquilibrer la balance commerciale US. Cette balance est aujourd’hui largement en faveur de la Chine. Les chinois crânent bien évidemment pour montrer leur rejet de cette sommation. Cependant, sur le plan des échanges commerciaux, ils n’achètent pas autant aux américains pour avoir un levier de pression comparable. Par ailleurs, l’empire du milieu s’est engagé devant des dizaines de pays africains, et partout dans le monde, sur un type d’assistance ou un autre, qui leur impose de mobiliser des centaines de milliards de dollars pour être au rendez-vous de leurs engagements. La Chine n’est donc pas en mesure d’intimider l’Uncle Sam en menaçant de brader le dollar, dont elle a besoin, sur la place publique. Les américains en sont conscients. D’une manière ou d’une autre, la Chine devra donc se résoudre, entre autres, à acheter davantage aux américains pour aller vers un compromis. Mais ce que la Chine achètera de plus aux américains, elle ne le prendra pas ailleurs, en Europe par exemple. Le commerce étant devenu une science en soi, les européens ne pourront alors, comme conséquence, plus vendre autant qu’avant aux chinois. A son tour, L’UE s’approvisionnera probablement moins en Chine. Si c’est le cas, les européens devront acheter ailleurs les intrants nécessaires aux Produits Finis qu’ils nous vendent, à partir de Matières Premières achetées chez-nous. Cela poussera davantage les chinois vers nous et créera sans nul doute plus de frictions sur nos échanges avec l’UE. En somme, si nos partenaires de la rive nord méditerranéenne sont peu compétitifs sur les marchés africains aujourd’hui, il est plus que probable qu’ils le seront encore moins dans les années à venir. Ainsi va le monde, la faute n’est à personne, simplement la sélection naturelle qui pousse les plus faibles à la marge du marché globalisé. Ce processus est apparemment bien enclenché pour la « vieille Europe ».
Pour revenir à notre futur commerce avec des pays autres que l’UE, ce à quoi nos pays africains doivent se préparer, nous devons montrer aux autres que nous avons quelque chose à offrir commercialement pour participer à ces échanges. Sous ce rapport, il faut être parfaitement naïf pour considérer que la simple continuation de la vente de nos Matières Premières nous permettra d’aspirer à un quelconque développement à côté des autres pays de la planète. Nous devons mettre en priorité la valorisation bien étudiée de nos ressources naturelles en Produits Finis pour pouvoir les vendre avantageusement sur le marché mondialisé. Il me revient cette anecdote instructive. Il y a une vingtaine d’année, Travaillant alors pour PhF Specialists, Inc. (Cabinet d’Audit américain), nous avions procédé à la certification HACCP* de la société Sardisud, Unité de traitement de poisson basée à Tan-Tan (sud marocain). Quelques mois plus tard, à l’occasion d’une opération portant sur environ cent quarante tonnes de conserves de sardines exportées sur le marché égyptien, Sardisud a eu la mauvaise surprise de voir sa marchandise en question bloquée par les autorités locales. Le blocage était motivé par le libellé (incompréhensible pour les égyptiens), sur le Bulletin d’Analyses Sardisud, d’une opération d’analyse dite « ABVT » pour « Azote Basique Volatil Total » (Indice d’appréciation indirecte de la qualité des conserves). Cette dénomination, et la technique même, n’est pas d’usage courant en dehors de notre environnement (limité) francophone. D’autres mesures directes de paramètres de salubrité, d’inspiration FDA, sont préférés à l’« ABVT ». Le problème a finalement été réglé (après plusieurs mois) en tranquillisant les autorités égyptiennes par l’envoi d’un Bulletin d’Analyses de clarification libellé selon les termes anglo-saxons, les plus en usage dans le marché globalisé. Sardisud y avait appris une bonne leçon. Donc, produire un aliment salubre est nécessaire, mais pour le vendre à l’international, il y a lieu d’adhérer aux règles du Système HACCP tel que défini et codifié par le Codex. Le libellé des Bulletins d’Analyses doit également respecter ces règles.
En réalité, la promotion du Système HACCP a surtout porté sur la salubrité du produit que le Système permet. L’accent n’a pas été assez mis sur l’apport du HACCP pour le travail même de production en ce qui concerne, en particulier, la possibilité d’améliorer (dans le sens de diminuer) le prix de revient du produit fabriqué. En effet, le HACCP, tel que rappelé plus haut, commande la maitrise des risques sur le produit à vendre localement ou dans le commerce transfrontalier. Le HACCP ne privilégie pas un procédé de fabrication sur un autre. Autrement dit, en comparant plusieurs procédés de fabrication d’un produit souhaité, un ingénieur correctement formé, peut y sélectionner le procédé qui justifie la meilleure gestion des risques sanitaires du produit et qui, dans le même temps, permet d’obtenir le prix de revient du produit fabriqué le moins cher possible. Ce type de comparaison n’est pas aussi difficile à faire qu’on le pense car la plupart des procédés de transformation industrielle des aliments sont dans les domaines publics et accessibles aujourd’hui via des organismes tels que le Codex, des Universités, des Instituts etc. Ce travail de démocratisation des principes industriels a été largement facilité lorsque l’Etat américain, à la fin des années soixante-dix du siècle passé, a mis à la disposition des secteurs privés des procédés de production alimentaire utilisés par l’armée US pendant la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui encore, de nombreuses entreprises de différents pays s’inspirent des techniques en question pour la transformation industrielle des produits de grande consommation.
Il est difficile de dire si nos opérateurs marocains profitent comme il faut de cette vague de démocratisation des principes industriels dans l’agroalimentaire. Mais, des opportunités que nos opérateurs manquent sont identifiables. Comme exemple, le cas des olives de table dont le Maroc est un gros producteur de dimension internationale. Les olives noires (Matière Première) sont lavées, ensuite séchées quelques heures dans une étuve à 60°C environ. Après, elles sont enrobées d’une fine pellicule d’huile d’olive avant d’être emballées sous vide à l’attention du consommateur final. Ce procédé, que j’ai pu voir utilisé par des opérateurs européens, ajoute peu de frais sur le prix de revient du Produit Fini. Les opérateurs de l’UE, en « intermédiaires » avisés, achètent donc les olives chez nous, les préparent comme sus indiqué et nous prennent des marchés partout dans le monde. Les olives noires d’opérateurs marocains, fréquemment traitées à la chaleur (autoclavées) pour l’export, ne peuvent tout simplement pas supporter la concurrence, pour être plus chères et avoir perdu bonne partie de leur intérêt organoleptique. Et combien de cas équivalents de cet exemple peuvent être observés ailleurs en Afrique ?
Avec la bonne volonté de nos décideurs, la Zleca, couplée à une large promotion de l’utilisation du HACCP, peut faire que notre continent, riche en ressources et en eau, puisse devenir autosuffisant en quelques années seulement. Cette condition reste bien sûr un prérequis à la stabilisation de la population d’Afrique dont la jeunesse peut alors relever le défi de l’amélioration des qualités de vie sur le continent. L’AEFS (Association des Experts Africains en Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires) est prête à s’insérer dans cette logique positive en apportant notre contribution là où il le faut pour booster le développement à l’international de nos secteurs agroalimentaire de produits dûment valorisés.
* : Récemment, le Référentiel HACCP a été rebaptisé HARPC (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls) dans la FSMA (Food Safety Modernization Act). L’approche de gestion du risque sanitaire reste la même pour ces deux systèmes.