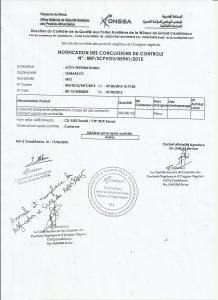Un nourrisson ne peut se passer de la tétée de sa mère. Éventuellement, il peut se contenter de la substitution d’un biberon ; mais quand vient le moment de le sevrer, il entame, pour son âge, une sévère résistance que rares doivent être les parents qui ne l’ont pas vécue. Les puissances coloniales vivent un peu les mêmes angoisses et engagent, à leur niveau, le même type de résistance au moment d’être sevrés de leurs colonies. Les britanniques ont été les premiers à souffrir de ce syndrome dont les français ont tirés ensuite quelques leçons. Ainsi, au moment où le tour de la France métropolitaine est venu de rendre à des Etats africains leur liberté, ils se sont arrangés pour le faire de manière très étudiée en maintenant leur mainmise sur l’économie de ces pays, en particulier sur le commerce de matières premières, agricoles pour ce qui nous concerne et minières également. Après, les français ont, comme on s’en doute, négocié âprement, au sein de ce qui est devenu l’UE, le privilège de « superviser » le volet agricole des relations commerciales entre UE et l’Afrique. La Grande Bretagne, l’autre ex-grande puissance coloniale du continent, devait acquiescer à ce consensus européen préétabli au moment de son adhésion tardive à l’UE.
S’agissant de la politique de l’UE sur le secteur agroalimentaire, africain notamment, la parole de la France était prééminente. C’est un énorme levier que la Métropole a utilisé jusqu’à la corde pour conserver son train de vie, largement injustifié autrement pour une puissance qui n’a cessé de perdre de sa superbe depuis soixante-dix ans. Mais le Brexit annoncé risque de mettre fin à cette politique française de rente, relent de l’époque coloniale, qui aurait pu, pour ce qui nous concerne, prendre fin dans les années soixante-dix déjà. A cette époque, la Grande Bretagne (GB), avec une économie tombée en chute libre, s’est résignée en tant que grande puissance à tendre la main pour l’aide du FMI. Le salaire moyen d’un ingénieur anglais était de l’équivalent de trois cents francs suisses, somme mensuelle allouée en Suisse en ces temps à un jeune apprenti. Du coup, de nombreux pays dans le monde ont recruté des ingénieurs anglais à volonté, pour leur recherche fondamentale, d’application ou bien dans des entreprises opérationnelles. La Suisse était dans ce cas. Mais l’Inde également qui ne l’a pas regretté car ces ingénieurs en question étaient parmi les mieux formés à l’échelle internationale dans de grandes Ecoles et Universités britanniques qui ont été, et qui restent toujours, à la pointe du progrès scientifique et technique dans le monde. Si l’Inde a réussi le tour de force de nourrir une population équivalente à celle de la chine pour un territoire juste au-dessus du tiers de l’empire du milieu avec des conditions climatiques peu favorables c’est grâce, notamment, à une approche inspirée du savoir-faire et de l’ingénierie britanniques. Mais, en raison d’une mainmise serrée de la France métropolitaine sur notre économie, nous n’avons pas pu nous même, ici au Maroc ou bien dans l’Afrique de l’ouest, profiter de cette manne de travailleurs anglais hautement qualifiés ce qui aurait aidé à réorienter notre politique sur le secteur agro-industriel davantage au profit de l’Afrique.
Des trois besoins fondamentaux de l’être humain, l’amour, la nourriture et l’eau, seul le premier a été sublimé. Le Taj Mahal, par exemple, a été érigé par un empereur pour l’amour d’une femme. Les besoins de se nourrir et de boire, nous les partageons avec les autres mammifères. Pour cette raison, la personne qui n’a rien à manger, ou à boire, est prête à risquer sa vie pour se sustenter. C’est ce qui arrive, et continue de se produire, avec la migration de la jeunesse africaine vers l’Europe depuis quelque temps déjà. Beaucoup de facteurs contribuent à cette détresse qui était, dans nombre de nos pays, simplement masquée par sorte de troc asymétrique conçu et mis en œuvre par la France coloniale pour ses colonies africaines et que la Métropole a prolongé au-delà des indépendances de façade. Mais depuis que les autres pays de l’UE ont pris conscience que le principal gagnant de la PAC (Politique Agricole Commune) était la France pour sa propre politique africaine ils ont, les britanniques en tête, engagé sorte de révolte pour changer les choses, c’est-à-dire payer moins sous ce registre ce qui a fait autant d’argent de moins qui devait aller dans les poches françaises. Depuis ce moment-là, la France a commencé à ressentir les limites de sa politique dite « Françeafricaine » qui était, en partie, possible grâce à la permissivité de la politique de l’UE, Allemagne en tête, en direction de la Métropole. Les britanniques étaient un contributeur net à la PAC alors que les français en ont été un bénéficiaire net. A présent que la GB a claqué la porte, l’Allemagne a vite compris qu’elle allait devoir mettre davantage la main à la poche pour assurer une part encore plus grande dans le budget de la PAC si elle veut la pérennisation de la Politique Agricole Commune. Sous ce rapport, le « Spiegel Online » rapporte, dans sa livraison internationale du 25 de ce mois de Juin : « … The common agricultural policy, for example, has for decades been nothing but a gigantic money redistribution machine without a discernible added benefit for Europe…» (Pendant des décennies, la politique agricole commune, par exemple, n’a été rien de plus qu’une grande machine de distribution d’argent sans aucun avantage pour l’Europe…). Il faut comprendre de cela que c’est la France essentiellement qui en a profité et que, par conséquent, cela doit cesser.
Il y a tout de même quelque chose de pas si orthodoxe que cela dans la réaction de la France, relayée par le Président de la Commission de l’UE, au Brexit. Car enfin, si l’on est sûr, comme les français le martèlent, que la GB est sur une route pour « se casser la gueule », alors la chose est entendue. Les gens vont le voir et cela découragera les autres de suivre l’exemple. Il n’y a donc pas besoin d’en rajouter en exigeant des britanniques de terminer à présent et immédiatement dans la précipitation leur union avec l’UE alors que la réglementation leur donne un délai de deux ans pour le faire. Il semble davantage que cette réaction excessive soit plutôt une réaction de quelqu’un qui perd son sang-froid à l’occasion d’un danger plus grand qu’il ne l’a imaginé sans que l’on sache quoi exactement. Serait-ce la peur de voir s’accélérer la levée de la mainmise française sur l’économie d’une grande partie de l’Afrique ? On subodore que la France voudrait voir être appliquées à la GB le plus rapidement possible les simples règles du commerce international sans autre privilège comme c’est le cas pour les USA avec cette différence que la GB ne pèse pas aussi lourd. Et, surtout, de faire souffrir les « Britishs » en leur appliquant le régime des barrières non-tarifaires comme elle fait pour d’autres pays africains, par exemple. Seulement voilà, il faut rappeler qu’à la base, les normes ISO, exigées haut et fort pour l’export des produits agroalimentaires africains sur le marché de l’UE, proviennent pour plus des deux tiers de normes britanniques et que la GB a tout à fait le droit d’en revendiquer la paternité. Il semble donc prématuré, dans cette hypothèse, à l’élève de faire la leçon au Maître à ce stade du bras de fer.
Mais, si le « Brexit » remet en cause l’ensemble de la politique de l’UE à ce jour, il s’y trouve une dimension qui pourrait jouer favorablement pour nous africains. D’abord, les anglais vont être libérés de leur attitude de réserve vis-à-vis de la politique que la France, au nom de l’UE, nous applique et la GB pourrait alors nous faire profiter d’initiatives intéressantes pour développer le commerce africain à l’international hors UE. Ensuite, il s’agit d’un pays d’à peu près la même population que la France pour une superficie d’environ un tiers seulement de cette dernière, qui importe donc de grandes quantités de nourriture et qui a un grand pouvoir d’achat étant la cinquième puissance industrielle du monde devant la France. De plus, les britanniques paieraient nos produits moins chers en dehors d’autres intermédiaires franco-européens. Enfin, une collaboration plus étroite du Royaume de Grande Bretagne avec le Royaume du Maroc pourrait faciliter des mises en contact de notre économie avec celle de l’Afrique orientale, où la GB est présente, ce qui bénéficiera à l’ensemble de l’Afrique.