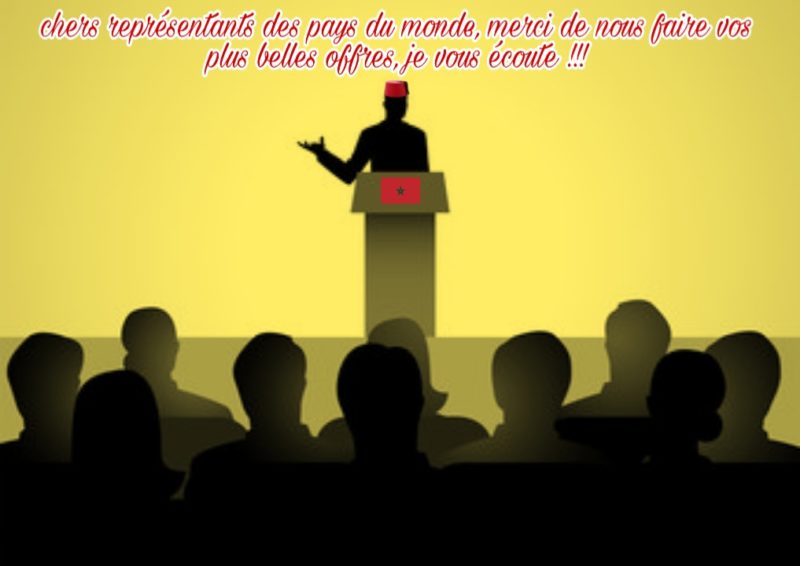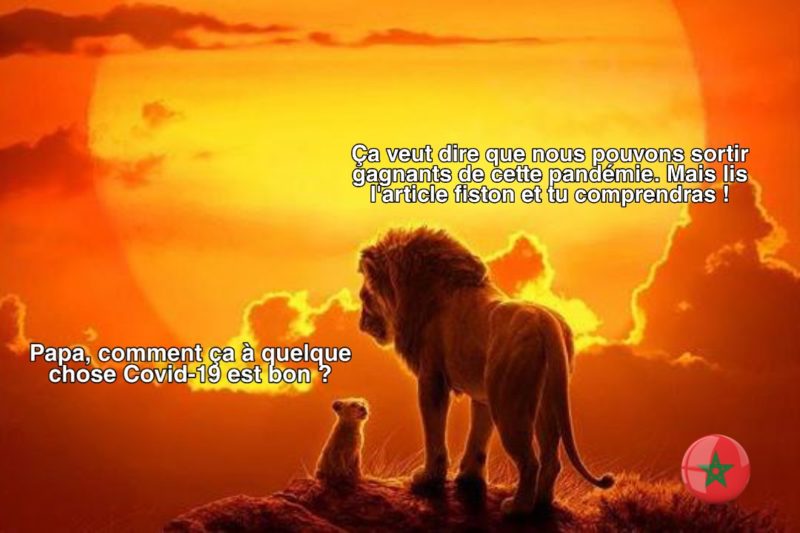Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à la mise en place d’un Nouveau Modèle de Développement (NMD) qui soit en phase avec les aptitudes réelles du Royaume et puisse profiter à l’ensemble du peuple marocain. Dans le même sillage, nous comprenons que la cérémonie de signature — du projet structurant de fabrication des vaccins Covid-19 et autres au Maroc — que le Roi Mohammed VI a présidée le 5 Juillet dernier au palais royal de Fès, participe également de la volonté royale de hisser la position du Maroc au rang de leader dans, entre autres, les domaines agroalimentaires, que nous aborderons plus bas, et pharmaceutique sur lequel nous saisirons l’occasion d’y revenir à un autre moment.
La commission chargée d’élaborer le projet du NMD, qui a terminé son travail et remis au souverain son étude renseignée, s’adresse à présent, sur demande du Roi, aux composantes des forces vives de la nation à travers le pays pour leur exposer les principales lignes de ce grand projet inédit et, dans le même temps, noter leurs avis et commentaires qui seront pris en considération dans la définition ultérieure des conditions humaines, matérielles et réglementaires de mise en œuvre du NMD. La presse nationale est revenue, à son tour, largement sur le travail de ladite « Commission Benmoussa » ainsi que sur le but visé du NMD dans son ensemble.
Pour ce blog, nous sommes particulièrement intéressés à l’amélioration que le NMD pourrait apporter à l’activité du secteur agroalimentaire pour élever nos prestations à un niveau supérieur et servir ainsi d’exemple à d’autres pays de notre région. Dans ce cadre, nous devons admettre que le système actuellement en vigueur — et les prescriptions qui le sous-tendent pour différents domaines de l’activité économique de notre pays — doivent avoir été considérés comme obsolètes, ou bien arrivés à leurs limites, pour que le Maroc se soit décidé à les changer. Le NMD devra donc, pour ce qui intéresse cet article, permettre aux opérateurs nationaux du secteur agroalimentaire de produire et mettre sur le marché des articles avec des rapports « Qualité/Prix » aussi performants que possible pour soutenir nos objectifs concurrentiels sur les marchés internationaux où la compétition est chaque jour plus féroce que la veille. Mais, la qualité des produits alimentaires, dont nous parlons, se mesure avec des méthodes réglementaires codifiées, qui figurent dans la loi 28-07 et dont le HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) représente le canevas de choix. Dans ces conditions, l’annonce du changement imminent du modèle actuel de développement autorise de conclure que, à côté d’autres insuffisances réglementaires identifiées, la loi en vigueur qui réglemente la qualité des produits alimentaires doit, à son tour, avoir été considérée comme nécessitant un « lifting ». Or, la loi 28-07 de sécurité sanitaire des produits alimentaires dont il s’agit, basée sur le HACCP et promulguée il y a juste une dizaine d’années, ne parait pas avoir vieillie à ce point. Sa lecture attentive, et celle des textes pris pour son application, montrent que les règlements qu’ils contiennent sont tout à fait en phase avec, en particulier, la protection du consommateur telle que prévue par le Codex Alimentarius et autres réglementations de référence.
Cependant, en y regardant de plus près on réalise, bien que la loi 28-07 soit claire dans son libellé et son esprit, que les responsables de l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires), à qui incombe exclusivement la responsabilité de mettre en œuvre cette réglementation, l’appliquent de manière discrétionnaire et largement partiale. Par exemple, la loi prévoit que les entreprises procèdent aux rappels, ou effectuent le retrait, de leurs produits reconnus non conformes. Je n’ai pas le souvenir, en observateur régulier de ce qui se passe dans le secteur des produits alimentaires, d’actions méritoires de l’ONSSA sur ce sujet. Ce fait n’autorise absolument pas d’extrapoler que tout ce qui est fabriqué dans nos Unités du secteur agroalimentaire serait parfait. Cela heurterait le bon sens scientifique et, en plus, une telle affirmation irait à l’encontre des observations objectives dans les nombreux pays qui ont le souci de l’application saine de la loi.
Ceci étant dit, la pertinence de la loi, nonobstant la qualité des textes réglementaires qui la composent, est tributaire de la façon dont elle est mise en pratique par ceux qui en ont la charge. S’agissant de l’application de la loi 28-07 et les textes pris pour son exécution, l’ONSSA, organisme intimement subordonné au Ministère de l’Agriculture, laisse, nos archives faisant foi, une impression de profonde léthargie. C’est comme si la majorité des agents de cette instance étaient là juste pour expédier les affaires courantes. Un exemple, parmi tant d’autres, est quoique la loi engage ces inspecteurs à mettre par écrit les écarts et autres manquements à la loi qu’ils peuvent observer dans les entreprises et établissements visitées lors de leurs inspections — de dater leurs remarques et les cosigner avec la hiérarchie présente de l’entreprise inspectée — ces verbalisateurs n’en font rien. Dans le langage commun cela s’appelle « Faire de la résistance à l’application de la loi » qui expose normalement à des sanctions disciplinaires ou bien le renvoi devant les tribunaux.
Comme on peut le supputer, ces fonctionnaires ne mépriseraient pas la loi sur laquelle ils sont supposés veiller s’ils savaient qu’ils auraient des comptes à rendre sur leur façon d’agir.
Les européens eux, avec lesquels nous avons un accord d’association, appliquent mieux leur loi chez eux que nous ne le faisons de la nôtre chez nous. Cela leur permet de faire, pour le secteur alimentaire et autre, des échanges commerciaux avec des pays partout dans le monde. Mais ce n’est pas le cas du Maroc dont plus des ¾ de nos exportations vont vers l’Europe et font leurs entrées dans le marché UE par un nombre très restreint de pays. Le Maroc étant un pays souverain, pourquoi alors notre commerce extérieur est à ce point dépendant d’une fraction infime de la population mondiale dont certains parmi eux racontent à qui veut les entendre qu’ils peuvent très bien se passer de l’importation de nos produits alimentaires.
Quoique cette anomalie (subordination excessive à un seul marché) de notre commerce extérieur ne semble pas avoir une explication intelligible dans les accords explicites qui nous lient à l’UE, il doit bien y avoir une raison à notre servitude d’un marché unique. La réponse serait donc à chercher ailleurs que dans les textes formels qui règlementent nos échanges avec l’Europe. Or, dans ce cas de figure, ce qui n’est pas dûment consigné relève souvent d’arrangements occultes. Sous ce rapport, on peut conjecturer qu’un battage continu sur des dizaines d’années — Qui loue la prétendue supériorité (à démontrer) des normes UE, combiné à des protocoles ciblés d’accréditation d’organismes officiels marocains gérés par des responsables acquis sans réserve au prosélytisme UE, le tout agrémenté d’intéressements d’individus ciblés pour des formations « généreusement offertes » sur les normes UE en Europe et/ou de décorations étrangères et/ou des facilitations de visas de voyage et j’en passe — auraient fini de formater l’esprit de certains de nos responsables et obtenu leur adhésion totale au paradigme UE.
Cerise sur le gâteau (pour ces gens), cette attitude de soumission pour ainsi dire aveugle, de certains de nos responsables aux thèses UE, conjugue bien avec l’économie de rente que l’Europe, via cette catégorie d’individus, veut perpétuer dans notre pays pour en faciliter l’exploitation dans la durée aux potentats européens.
A présent, si cela constitue une vérité de La Palice de dire que ce sont les pays de l’UE qui profitent éhontément de l’accord commercial avec le Maroc ; Il est tout aussi évident qu’un changement, quoique légitime, d’attitude du Maroc, qui orienterait nos échanges commerciaux différemment de ce qu’ils sont aujourd’hui, provoquera à n’en pas douter un tollé au niveau des décideurs UE et de leurs mandataires marocains. Les résistances évoquées plus haut se multiplieront à coup sûr dans le secteur agroalimentaire et ailleurs.
Sous ce rapport, le Der Spiegel relate, dans sa dernière livraison du 21 courant, dans un article consacré à la pandémie de Covid-19 que : « L’Allemagne est souvent bonne en gestion et mauvaise en création ». Cela rejoint ce que nous avons indiqué dans un article précédent (voir ici ). A ce propos, le Maroc peut se targuer à juste titre d’avoir conçu, préparé et conduit une campagne de vaccination, et gérer ses effets annexes, de manière magistrale qui continue d’inspirer d’autres pays dans le monde.
Aussi, certains de nos responsables du Ministère de la santé feraient bien de méditer sur le fait que ce n’est pas parce qu’une pharmacopée, ou un autre document de référence, est rédigée en français qu’elle est automatiquement meilleure qu’une autre rédigée en anglais ou bien en chinois ou autre (voir ici ).
En prenant appui sur ce qui vient d’être indiqué plus haut dans le texte, et pour mieux garantir le succès du NMD, il semble bien que le Maroc doive prendre le plus rapidement possible en considération, en particulier, les préoccupations légitimes de certains exportateurs auxquels la mise en œuvre du NMD risque de faire perdre des opportunités sur les marchés traditionnels et leur apporter aide et appui pour accéder à des marchés alternatifs qui existent. En parallèle, il y a lieu, selon notre appréciation, de réfléchir sur la problématique que posent ceux parmi nos décideurs de la haute sphère de la fonction publique, et ailleurs peut-être, qui montrent une plus grande inclination aux causes de pays étrangers qu’à celles de leur propre pays. Notre suggestion serait, au minimum, de réorienter la carrière de ces gens pour prévenir l’éventualité qu’ils puissent représenter un frein supplémentaire à la mise en œuvre du NMD auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé et dont notre pays a grand besoin.