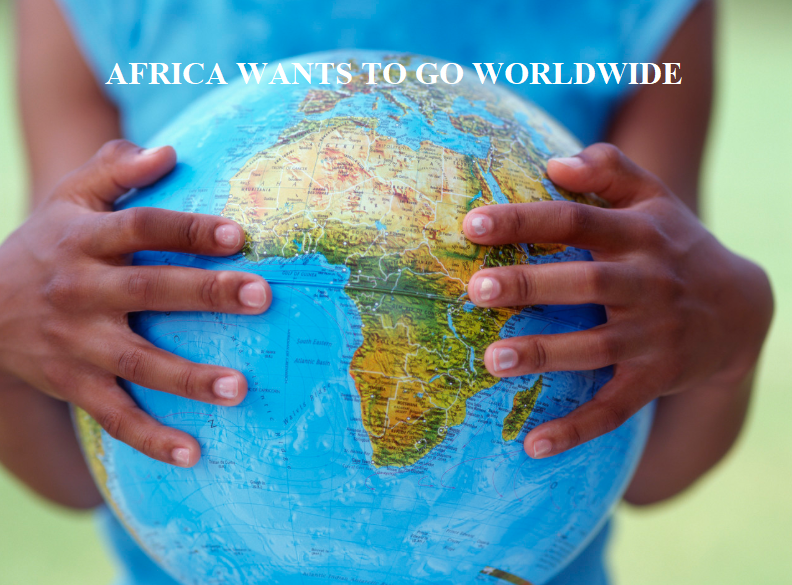Dans les années soixante-dix du siècle passé, alors étudiant à Lausanne, il m’arrivait d’écouter une émission hebdomadaire phare en ce temps-là de la radio-suisse romande qui s’intitulait « Fête comme chez-vous » que présentait l’animateur vedette, feu Michel Dénériaz. A l’occasion de l’une de ces émissions, il avait entonné, avec les participants, la chansonnette « Vive nous » que les romands chérissaient. Il y avait de quoi. En plus d’être alors le pays le plus riche du monde (par tête d’habitant), la Suisse a la particularité de vivre dans l’opulence, le calme et la sérénité.
Sur notre continent, même s’il y a reconnaissance que l’Afrique est potentiellement très riche, les populations qui y vivent ont été dans l’ensemble appauvries. De nombreuses raisons permettent d’expliquer cette anomalie, qui relèvent de notre colonisation passée, dont certaines qui ont trait au pillage systématique de nos ressources agricoles et agroalimentaires sont abordées çà et là dans ce blog. Ce qui compte pour nous à présent c’est de se dire que l’on peut sortir de ce ghetto si on a la volonté de le faire.
Il est utile de rappeler, sous ce registre, qu’au lendemain de la dernière grande guerre, l’Allemagne était un pays complètement délabré et l’ensemble de sa population plongée dans une misère noire. Les allemands devaient, en même temps, trouver moyen de survivre dans une Allemagne ravagée, nettoyer le pays des millions de bombes, parfois encore actives, larguées pendant le conflit par les alliés partout dans les villes et les campagnes et commencer à reconstruire le pays. Assistés par les américains, les autorités allemandes ont fait appel à la population pour qu’elle apporte son aide à ce chantier titanesque. Les gens, qui n’avaient pour bon nombre d’entre eux plus de papier d’identité et/ou de légitimation devaient simplement indiquer leurs noms et prénoms et préciser leur type d’activité et/ou leur savoir-faire. Sur cette base, et sur rien d’autre, de l’argent, car il en fallait, leur était remis pour leur permettre d’effectuer les tâches qui leur étaient allouées. Les américains, qui apportaient l’essentiel de cet argent par le biais du Plan Marshall, n’exigeaient aucune garantie réelle pour l’avance de cet argent et les responsables allemands faisaient confiance à leurs citoyens pour le bon usage de cette manne. On sait ce que l’Allemagne est redevenue ensuite.
D’autres pays se sont également retrouvés momentanément piégés dans la misère et en sont sortis en faisant confiance à la loyauté et au génie de leurs citoyens. Cela a notamment été le cas du Japon et de la Corée du Sud.
La colonisation, aussi dévastatrice sinon davantage que la guerre même, a laissé, dans le cas du Maroc, un pays choqué, épuisé avec des caisses vides. Par suite, depuis son indépendance de la France coloniale, le Maroc donnait, pour des considérations qui dépassent les intérêts de ce blog, largement l’impression de faire du sur-place. Par exemple, il y a une trentaine d’années, notre pays n’avait pas à un certain moment de quoi payer en devises un chargement de céréales et le bateau a dû repartir de Casablanca sans décharger sa cargaison ! Mais, depuis une vingtaine d’années, le Maroc a entrepris de reprendre son destin et son libre arbitre en main. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Aujourd’hui, il suffit qu’un organisme institutionnel marocain exprime sur le marché international un besoin de financement pour recevoir plusieurs fois le montant voulu et sans garantie de l’Etat.
Il y a au Maroc consensus national à ce que cette reprise en main du pays a commencé en redonnant confiance aux marocains en eux-mêmes et ce qu’ils peuvent accomplir à travers, par exemple, le lancement de l’Initiative Nationale pour le Développement humain, ou INDH (http://www.indh.ma/) par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les années deux-mille. Un grand nombre de jeunes et moins jeunes ont reçu de l’argent, plus ou moins, pour s’employer à des tâches qui leur ont permis de regagner confiance dans le travail rémunérateur. L’argent leur a été remis sur une base de confiance dans leur savoir-faire sans autre exigence de garantie de quelque nature que ce soit. Or, la garantie matérielle a toujours été un préalable pour accéder à un prêt bancaire quel qu’en était le montant. En réalité, cette exigence de garantie matérielle systématique pour accéder à un crédit bancaire est à l’origine d’une grande partie de nos maux en Afrique et a contribué grandement à nous maintenir dans le statut de sous-développés. Et cette contrainte porte l’empreinte des bailleurs de fonds principalement européens pour maintenir un statu quo qui profite au sein de l’élite marocaine à une petite minorité active qui a à cœur de nous maintenir dans le statut de colonisés économiques.
Après la pleine réussite de cette première initiative au profit des plus démunis, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses instructions, dans son discours à l’ouverture de la session parlementaire d’Octobre passé, pour le renouvellement de cette approche mais en plus grand et avec plus de moyens pour consolider le développement économique du pays. Déjà, les jeunes qui ont des projets peuvent à présent bénéficier de prêts sans conditions préalables de garantie réelle ou de garantie personnelle et partout au Maroc.
Pour apprécier la valeur de ces initiatives, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du secteur agroalimentaire africain, il est largement subordonné, directement ou commercialement, à des donneurs d’ordre européens. Par ailleurs, selon nos connaissances, l’UE avait pris ses précautions et pousser le Maroc à s’engager pour réserver aux européens les mêmes avantages commerciaux qu’il serait amené à offrir à un autre acteur commercial. Somme toute, les européens ont pensé à tout pour rester le maître d’œuvre de nos projets agricoles et agroalimentaires jusqu’à la fin des temps. Avec les initiatives royales susmentionnées, dont bénéficieront les marocains (africains) d’abord, le Royaume se libère de manière élégante de cette obligation de faire pareil pour les européens. En somme, nous reprenons notre souveraineté sur nos richesses agricoles et sur leur transformation ainsi que notre libre arbitre pour les exporter là où nous le souhaitons et d’abord en Afrique.
Mais l’export est tributaire à présent de l’adhésion à des normes de référence qui ont la confiance des consommateurs. Avec le blocage de l’OMC, pour avoir été lourdement décrédibilisée (voir sous http://alkhabir.org/fr/renaissance-commerciale-africaine/), l’Europe continentale perd un argument de poids qui lui permettait de brandir la menace de recourir à cet organisme contre un pays africain qui ne respecterait pas à la lettre les normes UE. Ensuite, il y a le fait que le marché UE s’essouffle et, de l’avis de certains exportateurs, ce marché est de plus en plus spéculateur et de moins en moins rémunérateur. Il y a donc besoin, pour nos opérateurs africains, de voir, tout en gardant nos débouchés européens, pour conquérir d’autres marchés plus rémunérateurs qui se trouvent en Amérique et en Asie. Or ces pays appliquent depuis toujours les normes FDA. Ces normes dérivent à présent de la nouvelle loi américaine de sécurité sanitaire des aliments dite Food Safety Modernization Act ou FSMA. La loi en question est présentée de manière didactique dans le manuel : https://www.ifsh.iit.edu/sites/ifsh/files/departments/fspca/pdfs/FSPCA_PC_Human_Food_Course_Participant_Manual_V1.2_Watermark.pdf
En diversifiant notre export, nous aurons plus de chance de profiter de toutes les ressources potentielles africaines dont nous disposons. Et qui sait, peut-être que nous pourrions à un moment dans l’avenir entonner à notre tour la chansonnette : « Vive nous les africains ».
Nous souhaitons bonne chance à tous nos opérateurs des secteurs agroalimentaires africains.